Brigitte Giraud, lauréate du Prix Goncourt 2022 se confie dans le podcast « Keskili ».
- formationmmc
- 16 nov. 2022
- 6 min de lecture
« Lire, ça permet de vivre deux fois, en fait ! ».
Brigitte Giraud a été récompensé par le Prix Goncourt le 3 novembre dernier grâce à son nouveau roman Vivre Vite. Cette semaine, l'autrice est l’invitée de la saison deux du podcast « Keskili » dans lequel elle se confie sur l’écriture de son œuvre, sur son goût pour la littérature, son rapport à la vie et ses plus beaux souvenirs littéraires.
A 41 ans, Claude meurt brutalement dans un accident de moto. Ce drame a eu lieu il y a vingt ans et sa compagne, l’écrivaine Brigitte Giraud, a choisi de le coucher sur le papier en publiant Vivre vite (Flammarion, 208 p., 20 €, version numérique à 14,99 €). Ce texte poignant a reçu le prix Goncourt le 3 novembre 2022, faisant de l’autrice la treizième femme récompensée par le jury délibérant à Drouant.
Sous la forme d’un compte à rebours haletant, le récit dessine la généalogie d’une disparition, et avec elle le portrait sensible d’un homme, guitariste et critique rock, et d’un couple insouciant, épris de musique et de littérature, à l’aube d’une nouvelle vie. Au fil d’une obsédante litanie de « si » qui donne sa scansion au récit, Brigitte Giraud rouvre la « boîte noire » et traque méthodiquement le moindre fait, le moindre geste, la moindre décision, afin de mettre à nu les ressorts de l’existence.
Après une saison 1 enregistrée en 2021, Brigitte Giraud était l’invitée de la saison 2 du podcast « Keskili » du « Monde des livres » réalisé en partenariat avec le salon du livre du Mans, Faites lire !. Au micro de la journaliste Judith Chetrit, elle se confie sur son goût de la lecture et de la littérature.
Quel est votre meilleur souvenir de lecture ?
Le meilleur souvenir de lecture, c’est aussi le premier, celui d’un livre qui n’est pas de littérature puisqu’il s’agit d’un livre de la « Bibliothèque verte » écrit par Paul-Jacques Bonzon, L’Eventail de Séville. Il m’a absolument marquée d’abord parce qu’il me déplaçait au niveau du lieu. Moi, j’habitais dans une cité proche de Lyon et je ne soupçonnais pas l’existence de la ville de Séville. J’avais 11, 12 ans. On ne m’en avait encore jamais parlé. Et puis il y avait le nom du fleuve, le Guadalquivir. Je trouve ça merveilleux, comme nom de fleuve. J’ai beaucoup rêvé autour du Guadalquivir, que j’ai fini par aller visiter.

On dit que dans la vie il n’y a pas de brouillon : on ne peut pas corriger, rectifier, comme dans un livre…
J’ai plutôt l’impression que l’existence est un long brouillon, qu’on fait des essais. Puis, quand on commence à comprendre comment ça marche, c’est terminé. Et l’écriture est une possibilité de rectifier le tir. C’est là où on peut faire des pas de côté, se soustraire à notre quotidien et entrer dans un autre quotidien où tout est plus violent, plus noir, plus lumineux. Le rapport au désir, parce que le temps est donné pour regarder de très près : on a le temps de s’installer et de regarder. Lire, ça permet de vivre deux fois, en fait.
Avez-vous de mauvais souvenirs de lecture ? Des livres qui vous tombent des mains ?
Pas tellement, parce que lorsqu’un livre me tombe des mains, je passe à un autre. Je ne m’entête pas à essayer de lire un livre qui me résiste. Pour autant, je n’ai jamais lu jusqu’au bout A la recherche du temps perdu [de Marcel Proust]. Pendant la première période de confinement, j’ai cru que le moment m’était donné. Je me suis dit que j’allais m’installer tranquillement dans un canapé, prendre les premiers volumes de La Recherche, puisque j’avais vraiment le temps d’y aller…
C’était un moment où le rapport au temps avait changé…
Le temps était complètement distordu, il s’étirait, mais c’était un moment de grande inquiétude aussi. Je parcours alors les trente premières pages, que j’avais déjà lues quand j’avais 17 ou 18 ans. Je recommence vraiment depuis le début, de façon assez obsessionnelle, en voulant, comme toujours, bien faire, dans le bon ordre. Et au bout de trente ou quarante pages, j’ai tout envoyé péter parce que j’avais l’impression qu’il fallait être dans une attitude bourgeoise assez tranquille, sans être dérangé, surtout sans que l’esprit soit dérangé.
Y a-t-il des livres que vous aimez relire ?
Oui, il y en a plein ! J’aimerais relire Camus. Je suis née en Algérie, mais ce n’est pas l’unique raison. J’ai l’impression que c’est maintenant que je peux comprendre L’Etranger. Maintenant que je sais aussi quel a été le destin de Camus, sa mort prématurée en janvier 1960 dans un accident qui a eu lieu alors qu’il n’aurait pas dû avoir lieu. Camus n’aurait pas dû prendre la voiture de son éditeur : il devait rentrer en train avec sa femme et leur fille. Et puis, au dernier moment, il y a eu quelque chose qui s’est détourné. Et c’est ça qui m’intéresse. Evidemment, c’est aussi parce que mon dernier livre parle de l’accident de mon compagnon et pose les questions de savoir s’il y a un destin ; est-ce qu’il y a une généalogie et des conditions, le cours des choses, qui généreraient un accident ? Est-ce qu’on y peut quelque chose à rebours ?
Et vous, y-a-t’il des livres que l’on vous a offerts à plusieurs reprises ?
A la recherche du temps perdu, justement ! Parce qu’on savait que je ne l’avais pas lu et parce qu’on ne savait pas que je ne le lirais pas tout de suite. Sinon, non, mes proches n’osent pas m’offrir des livres parce qu’ils savent que j’en achète beaucoup, que je lis beaucoup, et ils ont toujours peur de se tromper. Je crois que c’est difficile d’offrir un livre à quelqu’un qui écrit. En tout cas, ce que me disent des amis, c’est cette chose-là.
Ils ont peur de votre jugement quand vous ouvrirez le papier cadeau ?
Je ne sais pas, mais c’est très dommage. Chaque fois, je dis « mais non, mais offrez-moi des livres ! », au contraire, parce qu’offrir un livre ça parle quand même beaucoup de celui qui offre. Ça ne parle pas forcément de celui qui reçoit, comme tous les cadeaux.
Vous avez un endroit, un moment aussi, pendant lequel vous aimez lire plus qu’un autre ?
Avant, je lisais simplement une fois que la journée était écoulée parce que je n’étais pas disponible avant. Donc, le moment juste avant le coucher, avant de dormir. Et puis là, de plus en plus, je passe un peu de temps sur un réseau social et je m’en veux vraiment, sur Facebook, où je suis en lien avec des amis écrivains. Mais l’endroit où je lis vraiment, c’est dans le train. Le train est idéal pour lire, parce qu’il n’y a pas d’échappatoire. Il y a un temps qui est donné, qui est imparti, qui est en général deux ou trois heures, qui va bien avec le moment de lecture.
Et justement, pour votre dernier roman, Vivre vite, est-ce qu’il y a des livres qui vous ont inspirée, ou au moins accompagnée ?
Pour ce livre-là, je devais au contraire me débarrasser de tout un tas de choses plutôt que d’engranger. Je voulais surtout me débarrasser de tout ce qui pouvait avoir trait au deuil. Parce que Vivre vite, ce n’est pas du tout un livre de deuil. C’est un livre qui dit la vie avant et qui essaie de comprendre comment la vie dans ses différents emboîtements peut arriver à un point qui est un point de catastrophe. Pour autant, j’y fais référence à deux autres livres dont l’un de Patrick Autréaux dans lequel j’ai prélevé une phrase : « Ecrire, c’est se rendre à ce lieu qu’on voudrait éviter. » J’aime beaucoup cette idée de l’évitement. Et je fais référence à Philippe Forest qui, lui, a écrit différents livres chez Gallimard autour de la mort de sa petite fille de quatre ans, Pauline, dont L’enfant éternel, et cet autre que j’aime beaucoup, qui s’appelle Sarinagara. Cela qui veut dire « et cependant » en japonais ; il y fait référence d’une part à l’écrivain japonais Kenzaburô Ôé, qui lui-même a eu un enfant handicapé, mais surtout au deuil collectif qu’a vécu et que vit peut-être encore le Japon suite aux bombes d’Hiroshima et de Nagasaki. Ce que je trouve très intéressant dans l’écriture, c’est comment on peut faire résonner la part intime et la part collective.
Cindy CHASSELIN
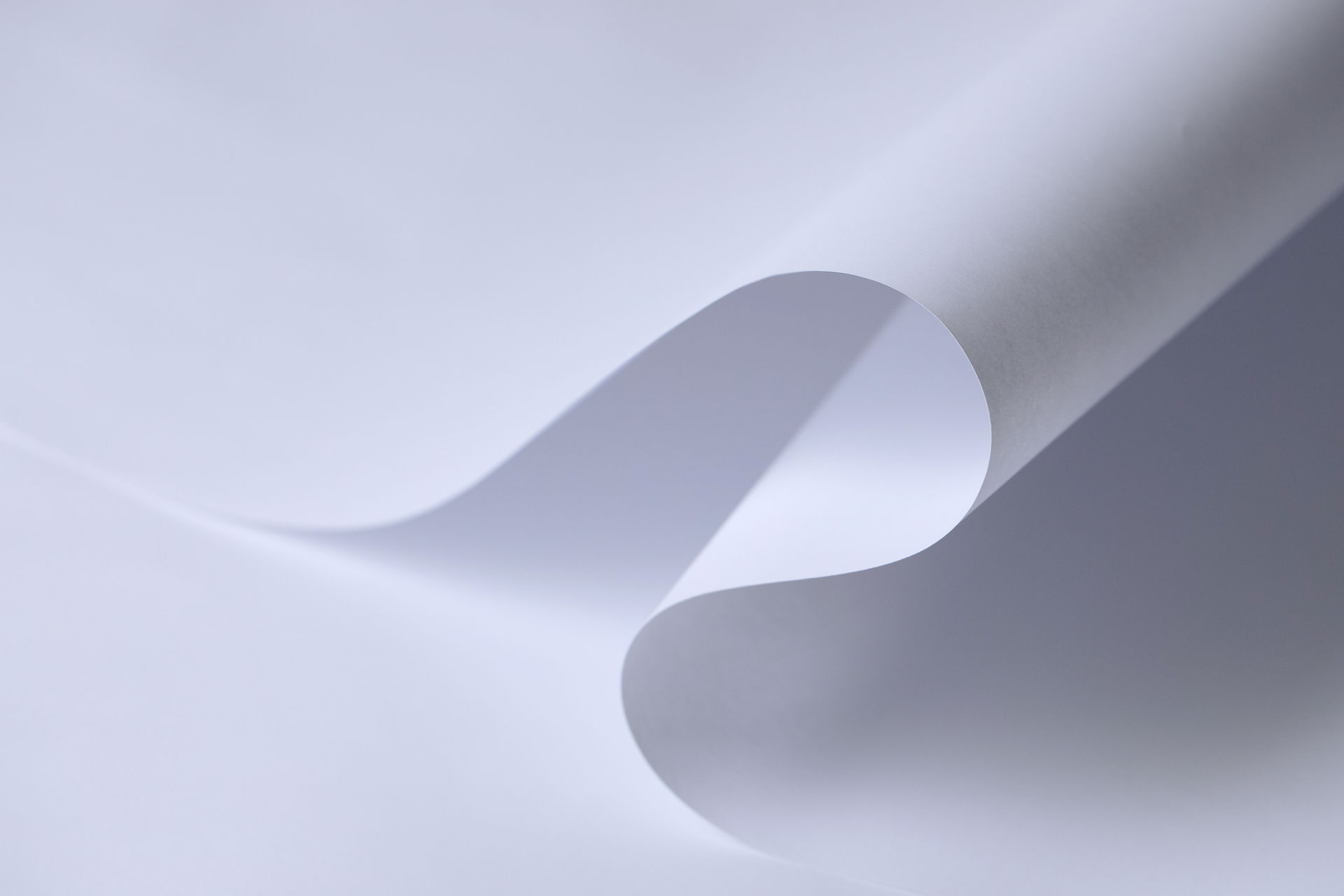



Commentaires